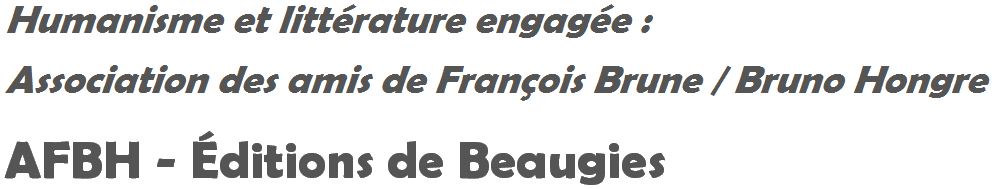
SOUBRESAUT
Il y a des mots qu’on n’aime pas, jusqu’à les détester parfois intensément. Ce n’est pas de leur faute, les pauvres : ils sont victimes des réalités qu’ils désignent, par contamination, ou d’images préconçues que nous nous faisons d’eux, qui nous indisposent, même si leur sens est apparemment neutre ; simplement, leur désinence, voire les échos de certaines syllabes, ou des paronymes malencontreux nous paraissent déplaisants., victimes de rimes inopinées. Voyez comment « con » ou « cu(l) » peuvent être ressentis comme trop expressifs pour qu’un écrivain pudique se méfie du long mot « concupiscence », ou au contraire y trouve l’occasion de déguster ses refoulements secrets en l’énonçant… Que ces réflexes, avant d’user d’un mot, soient liés à une expérience vécue ou à de purs préjugés, le « signifié » des termes a suffisamment imprégné leurs signifiants que cela brouille le sens des énoncés où on les réemploie ; c’est le cas, par exemple, d’une certaine éducation qui qualifie certains termes de « gros mots », si courts soient-ils… Je ne donne pas d’exemples, cela pourrait obscurcir mon propos…
Cela étant, si, pour le linguiste, tous les mots sont respectables, l’écrivain a bien le droit d’en exclure certains pour éviter de friser l’inconvenance, ou de frôler le faux sens.
Colette (l’écrivaine) raconte comment, gamine, le mot « presbytère » lui servait d’insulte, si bien qu’elle le balançait par-dessus les murs à l’égard de tout ce ou ceux qui avaient le malheur de lui déplaire. Le droit de signifier autorise chacun à se créer son dictionnaire, fût-ce au risque de se savoir enfin compris…
À l’inverse, il arrive que, par peur d’être politiquement incorrect, tel journaliste évite prudemment de nommer certains individus en les qualifiant de ce qu’ils sont, faisant montre par cette précaution de ce que précisément ils veulent éviter. Exemple : pour n’avoir pas l’air raciste, X évite de dire « un noir » pour un être humain qui est noir, laissant entendre, par ce scrupule, que le fait d’être noir serait infériorisant ; ou encore dire « un juif » pour quelqu’un qui est juif, par peur d’avoir l’air de le discriminer en lui attribuant un qualitatif en soi dépréciatif… On n’en sort pas !
En ce qui me concerne, je n’échappe pas à ces divagations. Il se trouve par exemple que c’est le mot « soubresaut » qui me déplait sans raison, que je ne supporte pas et dont je me servirais volontiers pour maudire ceux qui me paraissent surtout de sombres sots. Et pourtant, je connais bien le sens officiel de soubresaut (saccade corporelle, comme « sursaut » qui a le même sens). Mais voilà : je sens ce terme surtout proche de l’énoncé « sombre saut » que je me représente aussitôt la saccade involontaire d’un sujet humain qui s’agite face à une menace mortelle, par exemple la rébellion désespérée d’un moribond dont la carcasse agonise, et qui s’arc-boute sur le lit métallique d’hôpital où la Mort le persécute. C’est ça, un « vrai » soubresaut, à mes yeux horrifiés ! Je préférerais qu’on use de variantes, comme « drôle de saut » « sous-saut », « sale-saut », bête-saut » », etc., ou encore, jouant sur les voyelles, « saut saoul », « sobre-saoul », etc.
En fait, c’est l’attaque syllabique « soubre » que je ne digère pas, qui m’énerve et me semble si laide, alors que « sobre » ou « sombre » me paraissent des vocables moins raides, plus fluides, tellement plus clairs… J’aimerais avoir à décliner des vocables proches ou plus amusants : sourceau, saut-de-retard (cas d’un spectateur qui comprend après un temps d’arrêt un gag de Devos que la foule a saisi tout de suite), « sous-saut » s’opposant au « sursaut » (le sous-saut fait tomber, alors que le sursaut vous élève) ou encore « trompe-sot », pour qualifier l’état soudain d’un débile furieusement agité d’un « salto » arythmique !
Veuillez chercher avec moi, inventez mieux que je ne saurais le faire, prenez la parole sans vous laisser prendre aux mots existants.
Inventons ensemble :
À chaque sot son bon saut, son lasso et autres sots songes qui ne riment à rien. La porte est ouverte : laissons-nous aller aux soubresottises…
Le Songeur (18-09-2025)
(Jeudi du Songeur suivant (377) : « L’ « EFFET PLUME » ET LA SURPRODUCTION DE BEURRE EUROPÉEN » )
(Jeudi du Songeur précédent (375) : « SIDÉRATIONS » )