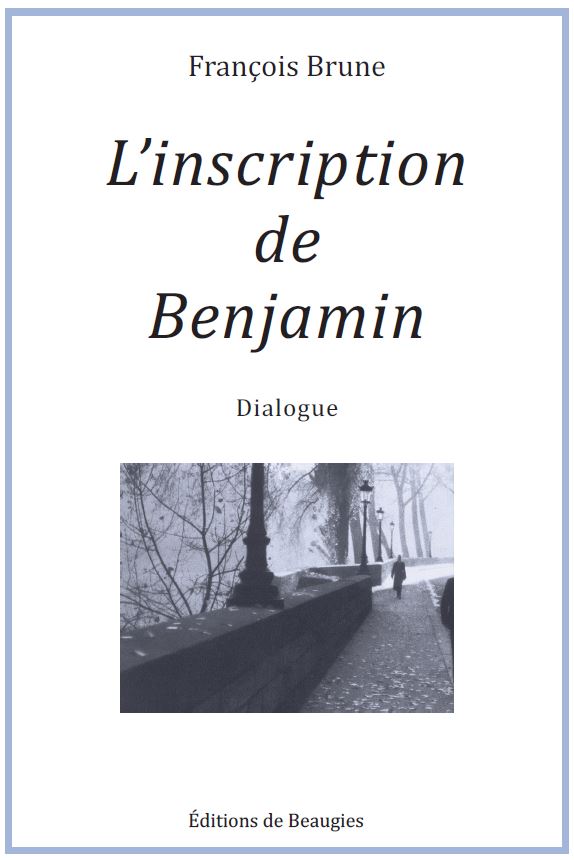Avis critique sur L’inscription de Benjamin
Par Colas Rist
Me voici bien embarrassé. J’ai lu L’inscription de Benjamin et j’ai écrit le texte qui suit, sans avoir au préalable pris connaissance de la présentation que François Brune fait de son livre sur son blog. Me reportant ensuite à cette présentation, je découvre bien des recoupements, qui rendent une partie de mon texte superflue. Je livre néanmoins ces lignes, — qui tiennent à la fois du compte rendu de lecture, de l’analyse et du commentaire personnel — pour ce qu’on pourra y trouver qui ne soit pas déjà dans la présentation de l’auteur.
Un pur face à l’humanité courante, aux êtres normaux, bienveillants, rieurs, obligeants, bien intentionnés, brillants, les pieds sur terre, et, les mêmes, égoïstes, moqueurs, grégaires, avides de domination, culpabilisants, tyranniquement exigeants d’intégration, prompts à châtier celui qui n’entre pas dans le jeu ou qui par sa générosité même les culpabilise involontairement, tolérants au premier abord et soudain férocement intolérants envers la différence.
Un pur, un humain qui ne connaît pas la pulsion d’agressivité mais seulement celle d’amour envers ses semblables auxquels il n’est pas semblable.
Est-ce que ce Candide existe ?
François Brune rêve qu’il existe. Et il l’introduit dans notre humanité.
Et il se demande comment va réagir et vivre parmi nous Benjamin, le pur, le naïf, l’innocent venu d’ailleurs et qui est ailleurs, l’éternel émerveillé dans ce monde, notre monde, vu comme un nouveau monde.
Il y a au cœur de ce livre une interrogation existentielle. On pense à Kafka, au Dostoïevski de L’Idiot (ou celui des Karamazoff, inventeur d’Aliocha), au Camus de L’Etranger, au Montesquieu des Lettres persanes, au Voltaire de Candide, à tant d’autres qui sous des formes diverses abordent cette question fondamentale : comment vivre dans ce monde, le nôtre, sans désespoir mais aussi sans se perdre ?
Nous sommes tous quelque part Benjamin et tous évidemment ceux qui lui ouvrent leur porte mais qui finissent par être déroutés, irrités, provoqués et rejetants.
La question existentielle et morale qui est le fil rouge du livre, F. Brune la développe sous la forme d’une fiction, et l’on pourrait même dire de deux fictions parallèles.
La première est une histoire : celle de Benjamin, arrivant à Paris dans le train, rencontrant deux jeunes filles, puis les familles, les amis, l’administration, la ville dans sa diversité, bref la société. Benjamin vient, c’est son mot, s’inscrire. S’inscrire parmi les autres. S’inscrire dans la réalité. Il vient exister, — être celui qu’il est et découvrir qui il est.
La seconde consiste en un dialogue entre deux devisants, l’un qui raconte la première fiction, qu’il a lue et, étrangement, connaît quasiment par cœur, l’autre qui écoute et réagit. Le tenant lieu de l’écrivain et celui du lecteur.
La gageure tentée par F. Brune est de mener les deux discours quasiment de front, en interrompant constamment la première par la seconde, en une série de séquences ou chapitres. Gageure, oui, car ce processus narratif oblige perpétuellement le lecteur à sortir de l’histoire pour suivre les interrogations que le devisant-auditeur adresse au raconteur, sur les étranges comportements du protagoniste et, corrélativement, les invraisemblances apparentes de ce personnage et les lacunes du récit. Sans cesse on passe de la fiction au métadiscours. Gageure risquée : parions que maint lecteur acceptera difficilement de se faire réveiller constamment du rêve fictionnel. Certes le lecteur a pour porte-parole dans le dialogue l’auditeur qui, lui aussi, se plaint que les scènes ne soient pas assez développées, mais les légitimations que donne le représentant de l’auteur ne feront peut-être pas taire la frustration du lecteur réel : « En vérité vous êtes un malade du code romanesque ! Aucune de ces scènes de mélodrame (que vous réclamez) ne vaut ces quelques arrêts contemplatifs où les héros transparaissent à nos yeux, en deux répliques, ou en une rêverie. L’action, si elle existait dans ce livre, ne serait que développement monotone, banalement narratif, inutilement conforme. L’essentiel est contemplation. J’aime l’instant qui prélude : tout le reste est remplissage. » F. Brune réclame le droit de conduire un récit qui esquisse des situations sans les développer, qui invente des instants offerts à la contemplation du lecteur et se dispense de les enchaîner. L’écart est double donc à ce qu’il désigne comme le « code romanesque » : interruptions de l’histoire par le commentaire et succession d’esquisses situationnelles discontinues (hormis le fil rouge : Benjamin jeté dans la société). Ce dernier modèle de construction narrative est il est vrai celui de maints romans, mais F. Brune le pousse à l’extrême, narrant quasiment en résumé bien des scènes et préférant en indiquer tout de go le sens, dans un langage relativement abstrait, plutôt qu’en délayer concrètement le déroulement, au risque du « remplissage ». Un exemple : (Benjamin joue au piano un air qui dit « la tristesse éternelle » ) « Alors survient Cordélia, incarnation des heures surannées, le cœur déchiré par la mélodie. Elle a su aussitôt que c’était lui, elle a reconnu l’accent de l’exilé. Elle s’emplit de l’harmonie désespérée où se fond l’être de Benjamin, brûle de répondre à l’appel qui interroge la nuit, de crier son nom dans les ténèbres du temps... »
Cette dominante de réflexion, réflexion existentielle d’une part et réflexion littéraire d’autre part, fait courir à ce récit le risque de ne pas accrocher le lecteur. C’est elle pourtant qui en constitue la grande originalité du point de vue de la forme. Le postulat irréaliste qui préside à la définition du personnage (le Candide ne sait pas même ce qu’est l’argent, découvre-t-on au passage dans une scène), le choix de situations archétypiques, donc banales, mais ultra-signifiantes (la rencontre de l’amour, de la pauvreté, de la maltraitance...), la polarisation sur l’analyse, le va-et-vient entre l’histoire de Benjamin et le débat des deux devisants, toute ces données aboutissent à un récit d’une densité, d’une richesse de thèmes et d’une fertilité d’idées extrêmes. On peut dire de ce texte : c’est un roman qui est en réalité un essai. Mais on peut le regarder en sens inverse : c’est un essai qui est développé sur un mode romanesque et dialogué. Il apparaît alors comme une mise en situation très concrète, vivante, incarnée, des idées. L’humour, l’époustouflante vivacité du dialogue, les menus événements qui font rebondir cet entretien situé dans un café (cette donnée n’est jamais oubliée), la virtuosité des notations descriptives fugaces semées partout, rendent à mes yeux la lecture délectable.
Deux fils thématiques, en bonne part entrelacés. Tous deux excitants pour l’esprit. Le fil littéraire et le fil moral. Et le second, profondément prenant. L’innocent, celui qui rêve une ouverture totale aux autres, peut-il vivre dans notre société ? Pourrait-il, s’il existait ? La réponse est négative. Désespoir. Le lyrisme n’est pas loin. Mais l’écrivain de Benjamin, par pudeur, par énergie et par raison, fait primer l’humour dans son écriture.
Post-scriptum
Le dialogue est le support majeur de ce récit. Un dialogue d’une vivacité extrême, animé par des incidents divers. Un dialogue dans l’esprit de Diderot.
Dans la partie narrative on retrouve le goût de F. Brune pour la vitesse du récit. Mais la narration romanesque admet plus difficilement cette rapidité. Eviter la lenteur, la lourdeur, risque de faire manquer cette positivité qui est l’épaisseur. Benjamin est un personnage expérimental, par sa radicalité, un christianisme parfait : peut-il exister ? « Il rêve qu’il existe ». F. Brune le rêve et se demande ce qu’il devient. « Il serait dans le train... » Tout le récit pourrait être au conditionnel. On peut se demander : Et si l’auteur avait choisi, plutôt que la discontinuité de situations très nombreuses mais peu développées, un approfondissement de quelques situations suivies et un développement temporel plus enchaîné ? Par exemple la rivalité entre Eglantine et Cordélia et l’indécision de Benjamin à choisir (pourquoi faut-il choisir ?) entre elles deux, mériteraient un traitement moins expéditif que celui qui en est fait.
Ce n’est pas le sujet, dirait peut-être F. Brune. Et aussi : faut-il vraiment sacrifier à l’intrigue sentimentale et à la banalité qui la guette ?
L’esthétique aussi est une question existentielle...
L’esthétique de Benjamin est celle de la science-fiction.
Sachons donc accueillir et aimer Benjamin tel qu’il existe, dans sa différence. Il y a un vertige né de la multiplication même des situations, facettes du monde réel où est happé le touchant hurluberlu venu d’une autre planète pour s’inscrire parmi nous et qui, sans intention missionnaire aucune, devrait faire réfléchir notre monde sur lui-même. Mais notre monde a une énorme puissance de résistance à la culpabilité et au changement, il est une machine à normaliser et à rejeter le réfractaire....
Colas Rist (5-02-14)